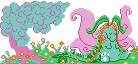Le seuil de la maison est une porte, et la porte est fermée.
« Natsume ? »
La voix de maman arrive à mes oreilles, mais je ne détourne pas le regard de la poignée. Son odeur est partout, mais je la trouve presque étouffante. La porte d'entrée est solidement fermée : et même si j'arrivais à m'en saisir, je sais que le second verrou me retiendrait bien assez vite. Maman n'avait pas eu plaisir à l'installer, je le sais, mais elle avait bien fait : sans ça, je me serais vite glissé hors de son attention. J'avais déjà réussi une ou deux fois, mais je n'avais fait que quelques dizaines de mètres, l'hiver d'avant. Alors elle avait pris des précautions.
« Natsume, mon dragonneau. Ne reste pas là. »
Les traits de mon visage restent crispés en une mine agacée. Mon regard reste fixé sur cette poignée qui ne bouge pas et qui ne bougera pas, même si je m'en saisis avec toute ma force. Je sais que c'est pour mon bien. Même à sept ans, je le sais. Je sais que si je sors, que si je tombe malade, je ne serai plus là. Comme le chat que nous avions jusque là, qui avait pris froid et qui était retourné vers Yggdrasil pour une nouvelle vie. Je ne veux pas laisser maman tout de suite ; même pour une autre vie. La maison est ce qui me protège, ce qui m'emprisonne mais je dois en tolérer la pression, car c'est pour mon bien. Pourtant...
« Natsume. Mon chéri. Viens avec moi. »
Pourtant, même lorsque la main de ma mère se pose avec douceur sur la mienne pour m'inciter à me retourner, mon regard reste fixé sur cette porte fermée.
Elle ne bougera pas.
La maison est une prison.
Je la vois s'ouvrir, de temps à autre, la porte.
Le matin, quand Nagisa part, et le soir, quand elle revient, la plupart du temps. La porte s'entrouvre, et les effluves de l'aube et du crépuscule passent dans l'interstice ; à force, je parviens à les distinguer nettement. A reconnaître l'humidité douce et fraîche de la rosée lorsque le soleil se lève, le parfum vigoureux et sec du vent lorsqu'il se couche.
Souvent, lorsqu'elle part, je suis encore au lit. Il est tôt : notre maison n'est pas la mieux placée par rapport à l'école et au centre de la cité, alors il faut partir quand le ciel est encore noir. La marche qui attend ma sœur est pénible. Il faudra qu'elle la fasse seule, pourtant. Quand elle me repère du coin de la pièce, son regard est plein de reproches. Je n'ai pas besoin de les entendre ou de les comprendre pour les sentir.
« Qu'est-ce que tu regardes, encore ? »
Nagisa n'a jamais été un dragon, mais elle en avait pourtant les crocs et la hargne, au contraire de moi. Avec tout le monde, cela dit, je n'étais pas spécial, mais je ne le savais pas.
Je ne le savais car je ne voyais pas d'autres personnes. Mon monde était bien petit : ma mère, ma sœur, moi-même, et mon père, parfois. Mon père et sa main que j'avais appris à craindre, sa voix qui grondait et qui me prenait aux tripes, me terrorisait parfois juste à entendre son timbre. Il arrivait, de temps à autre, qu'un moine s'introduise dans ce quotidien routinier, mais jamais pour bien long.
Nagisa, elle, pouvait s'en extirper. Sans surprises, je la jalousais. Viscéralement. C'est ce qui me faisait répliquer avec vigueur, fut un temps, lorsqu'elle me bousculait et m'attrapait par les cheveux lorsque nous nous battions, probablement trop régulièrement pour que ce ne soit normal. Pourtant, souvent, j'essayais de me rapprocher de cette frontière qu'elle pouvait traverser, et pas moi. J'espérais, peut-être un peu naïvement, trouver une sorte de guide. Ma sœur y voyait sans doute un poids lourd. A l'époque, je ne comprenais pas. Je me disais qu'il devait y avoir une bonne raison.
« Va te coucher, traîne pas là. »
Pourtant, à chaque fois que j'observais la porte se refermer derrière Nagisa, il y avait quelque chose dans mon ventre qui me donnait envie de courir à sa suite. De partir avec elle.
La maison est mon seul monde, car celui de dehors devait être bien rude. Sûrement. Sinon, toute ceci était injuste et il n'y avait pourtant personne à blâmer. Forcément.
Forcément.
La maison, ce sera ma tombe.
La porte claque.
J'ai un peu moins de douze ans quand je me rends compte que la maison est aussi un refuge.
C'est le calme. La paix. La tranquillité, le silence, l'absence de cri, de bruits, d'odeurs. Le rien doux face à la cacophonie de tout le reste. L'odeur étouffante mais familière du vieux bois et des fleurs de maman. J'ai passé des années à espérer quitter un foyer pour découvrir l'extérieur et je me rendais compte, comme le dindon de la farce que j'étais, que je ne pouvais pas le supporter. Que tout m'agressait. Qu'en fin de compte, ils avaient tous raison : je n'étais pas fait pour le quitter. D'ailleurs, je n'étais fait pour nulle part.
La porte se ferme. J'entends les bruits de pas de ma mère, signe qu'elle a entendu mon arrivée et voudrait me saluer, mais pour la devancer, je vais volontairement plus vite. Je me réfugie dans la chambre et ferme derrière moi comme un voleur qui se serait introduit par effraction. Ma mère ne me voit pas beaucoup, pendant cette période. Si j'avais su, d'ailleurs, je ne me serais jamais montré aussi ingrat. Mais j'imaginais, somme toute assez sottement et comme n'importe quelle jeune personne, qu'elle serait toujours là. Qu'elle serait toujours capable de me parler ou de m'entendre. Mais à ce moment-là, toutefois, je ne voulais rien d'autre qu'être seul, à nouveau. Me débarrasser de cette douleur sourde dans le coin de ma tête, de ce brouhaha vampirisant, de cette nuée qui m'écrase la tête et la poitrine.
Seul, il n'y a rien. Rien du tout. C'est le silence, l'attente. C'est un tombeau paisible, mais c'est toujours mieux que le reste. Il y a mes livres, ceux que j'ai déjà lu des dizaines de fois et que je pourrais citer sans faire d'erreurs, les quelques plantes dont je peux m'occuper dans le jardin. Maman est de moins en moins présente, de toute façon. J'ignore depuis quand son travail est si prenant, mais j'évite de m'interroger plus que ça. Je n'ai pas vraiment envie de creuser. Nagisa ne revient quasiment plus qu'une fois la vie tombée.
Mais je me demande, même à cet âge, si c'est normal, d'avoir cette impression de vide froid dans la poitrine en permanence.
La maison est tout ce qu'il reste, pourtant.
Je ferme la porte en douceur. Derrière la bicoque qui sert à abriter ma mère, derrière mon bureau au sanctuaire. A chaque fois, sans qu'on ne me suive, le regard fatigué et les yeux baissés, les épaules lourdes d'un poids qui est le mien à porter. Le parfum des médicaments me pique le nez.
Le logement dans lequel ma mère, ma sœur et moi avions été parqués n'est pas une maison ; tout au plus, c'est une pièce de soins. Une pièce de soins où je suis le seul médecin, puisque Nagisa ne me fait plus grâce de sa présence depuis des mois au moins. Tant mieux. La culpabilité remonte toujours dans ma gorge quand j'y pense, mais elle s'amenuise à chaque fois que je pense à ce que je dois faire pendant qu'elle perd son temps à s'apitoyer sur son propre sort.
Le sanctuaire est morne. Depuis la mort d'Erys, j'ai l'impression que son âme est partie avec lui. Est-ce vraiment ça, ou est-ce moi, qui suis désabusé ? Est-ce moi, qui ai perdu ce qui me rendait plein d'espoir ? Ou, alors, est-ce que les images que je me faisais se sont effacées en même temps ? Sans doute est-ce de ma faute. J'ignore quand cette lassitude m'a rendue si aigri et éreinté. J'accomplis mon devoir car on me fait confiance, car on a consenti à me faire confiance, à moi qui n'était rien qu'une déception et une perte de temps. A moi qui n'avait jamais vraiment fait quoi que ce soit d'utile. Je le fais car j'ai demandé et quémandé, même, qu'on me laisse une chance pour ce qui était ma vocation. On m'a laissé cette opportunité. On a même fait de moi un moine supérieur en dépit de tout.
Pourtant...
Pourtant, alors que j'entends la voix d'un novice m'appeler à nouveau pour je ne sais quelle urgence urgente, quelque chose se noue dans ma gorge. Le poids sur mes épaules s'étend à mon ventre. La pensée qui me traverse est amère,
La maison c'est un fardeau.
Une porte qui claque, à nouveau. L'odeur fraîche et humide de cette nuit d'été orageuse m'avait semblé presque une agression de plus, lorsque je m'étais retrouvé dehors. Par mes mains, à nouveau. Je ne pourrai jamais dire qu'on ne m'en a pas tendu, mais je les ai toutes renvoyé à chaque fois, sans forcément que je n'arrive à l'expliquer. Il fallait que je les éloigne.
Ce soir-là, ce n'était pas Daichi, qui m'avait chassé. Il ne l'aurait jamais fait. Malgré toute l'inquiétude que je lui avais fait supporter, malgré les tracas que je lui avais causé, il m'aurait toujours accueilli. Il aurait soupiré, grommelé, même, ou m'aurait fixé de ce regard muet mais orageux qu'il avait lorsqu'il était trop dépité pour parler. Jamais, pourtant, il ne m'aurait dit de partir. Il avait toujours souhaité que sa maison soit un refuge pour moi. Même alors que...
Libre à toi de vouloir rejoindre les éclaireurs, mais comprends bien que tu nous mets tous en danger.
Ce n'était même pas un reproche. Même alors qu'il aurait toutes les raisons du monde d'être en colère contre moi, même alors qu'il aurait pu s'inquiéter et, légitimement, privilégier la sécurité de ses enfants qui avaient déjà bien assez souffert de la disparation de leur mère et de leur sœur... Même là, il ne faisait qu'une constatation. Il ne m'obligeait à rien. Il ne me demandait pas de choisir entre ce toit qui avait brièvement été le mien et le reste. Il me demandait de faire attention.
Sur le moment, je ne l'avais pas saisi. Il y avait plutôt dans mon esprit une pensée amère et acide qui rongeait tout le reste, comme si j'étais déjà persuadé de quelque chose et que tout cela ne faisait que confirmer ce que je savais déjà.
La maison, c'est nulle part.
J'ouvre la porte. Sans lenteur et sans vigueur, l'expression tranquille, mes traits s'adoucissant lorsqu'une odeur devenue familière de sucre chaud et de cacao remonte à mes narines. Elle s'entremêle à celle des violettes et des bleuets que j'ai accroché dans un coin du foyer. Elles ont bien poussé ; plus que je ne l'aurais cru, à vrai dire. Je ne pouvais pas me résoudre à les laisser mourir dehors, néanmoins.
Je n'ai pas le temps de faire plus de trois pas qu'un brouhaha de pattes glissantes me parvient aux oreilles. Les chiens me sautent sur les genoux et me font grimacer de par leur enthousiasme, à peine atténué par les caresses que je leur offre puisqu'il les quémande en pleurnichant comme si j'étais parti des années.
« Doucement, Smaug. Yggdrasil, tes griffes... »
Je rouspète sans virulence, jetant des coups d'oeil aux ongles de nos – des chiens qu'il faudra penser à couper, à l'occasion. Il est tard, alors ça sera pour un autre jour. J’espérais juste que le vacarme causé par les chiens n'alertait pas l'occupant principal de la maisonnée, dont j'ignore encore la présence ce soir. Il arrive parfois qu'il soit dehors, même si cela me semble être devenu de plus en plus rare depuis peu. Il faudra que je lui demande pourquoi, à l'occasion.
J'entends des sons de ronflement, un peu plus loin. Instinctivement et sans même que je m'en rende compte, un sourire tranquille se dessina naturellement sur mes traits.
J'avance en douceur, mesurant le poids que je pose sur mes pieds pour ne pas provoquer trop de bruit. Sur le canapé, une silhouette est endormie dans une position que je trouverais franchement inconfortable si j'étais à sa place. Il est tard, alors je ne suis pas surpris qu'Enodril ait fermé l'oeil, mais c'est davantage le fait qu'il ne soit pas dans son lit, qui m'étonne quelque peu. M'étonne et ne m'étonne pas, en même temps. Car en jetant un coup d’œil à la scène, je comprends ce qui s'est passé.
Un chocolat chaud traîne sur la table du foyer. Le fumet est encore frais, visiblement. Il a été fait il y a peu de temps, mais son cuisinier ne se l'était pas destiné ; il aurait disparu, sinon.
Il l'a fait... Pour moi.
Mes joues prennent des couleurs. Ma gorge se noue quelque peu. Le geste n'est pas si surprenant, en soi. Il est arrivé, de temps à autre, que je prépare le repas lorsque je savais qu'il rentrerait tard, afin de lui laisser une assiette. Que je lui garde des restes pour qu'il mange autre chose durant sa journée, parfois. Et de la même façon, petit à petit, il s'est mis à faire la même chose. C'est devenu comme un réflexe. Il était devenu impensable de ne pas penser au confort de l'autre, ou de ne pas se demander comment se terminerait sa journée. De ne pas attendre, même, pour prendre un repas. Et c'est ce qui est arrivé ce soir. Il m'a attendu. S'est assis sur le canapé, sûrement en se disant que je ne rentrerais pas tard. Jusqu'à l'épuisement.
En silence, je m'accroupis, pliant mon genou pour observer son visage. Cela fait quelques semaines, maintenant, que j'occupe une part de son domicile. Le temps commence à devenir long. Je sais que j'aurais peut-être dû partir il y a un moment maintenant, et que j'éternise sûrement mon passage. Mon but n'est pas de m'imposer ni de le déranger. Pourtant, j'ai du mal à me faire à l'idée. L'égoïsme de cette pensée me gêne quelque peu, mais parfois, comme ce soir, j'ai l'impression que ma présence ne le dérange pas. Qu'elle lui fait du bien, même, bien qu'il soit possible que j'imagine des choses.
Délicatement, mes doigts viennent se poser sur quelques mèches de cheveux que je replace au dessus de son visage. Le geste est inconscient, comme le sourire doux sur mon visage. Pendant une seconde, juste une, une certitude me traverse. Je ne la comprends toutefois pas encore pleinement. C'est un sentiment plus qu'une pensée. Un nuage chaud, un instant d'écart. Je me sens bien. J'aime revenir ici. J'aime prendre soin des fleurs que j'ai commencé à faire pousser, j'aime m'embêter à y cuisiner même si ce n'est pourtant pas le premier de mes talents. J'aime ouvrir la porte en sachant qu'on m'y attendra. Et je suis sûr d'une chose.
Ce n'est pas tant les murs, que j'ai du mal à quitter.
Peut-être que la maison, au fond, c'est...
« Natsume ? »
La voix de maman arrive à mes oreilles, mais je ne détourne pas le regard de la poignée. Son odeur est partout, mais je la trouve presque étouffante. La porte d'entrée est solidement fermée : et même si j'arrivais à m'en saisir, je sais que le second verrou me retiendrait bien assez vite. Maman n'avait pas eu plaisir à l'installer, je le sais, mais elle avait bien fait : sans ça, je me serais vite glissé hors de son attention. J'avais déjà réussi une ou deux fois, mais je n'avais fait que quelques dizaines de mètres, l'hiver d'avant. Alors elle avait pris des précautions.
« Natsume, mon dragonneau. Ne reste pas là. »
Les traits de mon visage restent crispés en une mine agacée. Mon regard reste fixé sur cette poignée qui ne bouge pas et qui ne bougera pas, même si je m'en saisis avec toute ma force. Je sais que c'est pour mon bien. Même à sept ans, je le sais. Je sais que si je sors, que si je tombe malade, je ne serai plus là. Comme le chat que nous avions jusque là, qui avait pris froid et qui était retourné vers Yggdrasil pour une nouvelle vie. Je ne veux pas laisser maman tout de suite ; même pour une autre vie. La maison est ce qui me protège, ce qui m'emprisonne mais je dois en tolérer la pression, car c'est pour mon bien. Pourtant...
« Natsume. Mon chéri. Viens avec moi. »
Pourtant, même lorsque la main de ma mère se pose avec douceur sur la mienne pour m'inciter à me retourner, mon regard reste fixé sur cette porte fermée.
Elle ne bougera pas.
La maison est une prison.
–
Je la vois s'ouvrir, de temps à autre, la porte.
Le matin, quand Nagisa part, et le soir, quand elle revient, la plupart du temps. La porte s'entrouvre, et les effluves de l'aube et du crépuscule passent dans l'interstice ; à force, je parviens à les distinguer nettement. A reconnaître l'humidité douce et fraîche de la rosée lorsque le soleil se lève, le parfum vigoureux et sec du vent lorsqu'il se couche.
Souvent, lorsqu'elle part, je suis encore au lit. Il est tôt : notre maison n'est pas la mieux placée par rapport à l'école et au centre de la cité, alors il faut partir quand le ciel est encore noir. La marche qui attend ma sœur est pénible. Il faudra qu'elle la fasse seule, pourtant. Quand elle me repère du coin de la pièce, son regard est plein de reproches. Je n'ai pas besoin de les entendre ou de les comprendre pour les sentir.
« Qu'est-ce que tu regardes, encore ? »
Nagisa n'a jamais été un dragon, mais elle en avait pourtant les crocs et la hargne, au contraire de moi. Avec tout le monde, cela dit, je n'étais pas spécial, mais je ne le savais pas.
Je ne le savais car je ne voyais pas d'autres personnes. Mon monde était bien petit : ma mère, ma sœur, moi-même, et mon père, parfois. Mon père et sa main que j'avais appris à craindre, sa voix qui grondait et qui me prenait aux tripes, me terrorisait parfois juste à entendre son timbre. Il arrivait, de temps à autre, qu'un moine s'introduise dans ce quotidien routinier, mais jamais pour bien long.
Nagisa, elle, pouvait s'en extirper. Sans surprises, je la jalousais. Viscéralement. C'est ce qui me faisait répliquer avec vigueur, fut un temps, lorsqu'elle me bousculait et m'attrapait par les cheveux lorsque nous nous battions, probablement trop régulièrement pour que ce ne soit normal. Pourtant, souvent, j'essayais de me rapprocher de cette frontière qu'elle pouvait traverser, et pas moi. J'espérais, peut-être un peu naïvement, trouver une sorte de guide. Ma sœur y voyait sans doute un poids lourd. A l'époque, je ne comprenais pas. Je me disais qu'il devait y avoir une bonne raison.
« Va te coucher, traîne pas là. »
Pourtant, à chaque fois que j'observais la porte se refermer derrière Nagisa, il y avait quelque chose dans mon ventre qui me donnait envie de courir à sa suite. De partir avec elle.
La maison est mon seul monde, car celui de dehors devait être bien rude. Sûrement. Sinon, toute ceci était injuste et il n'y avait pourtant personne à blâmer. Forcément.
Forcément.
La maison, ce sera ma tombe.
–
La porte claque.
J'ai un peu moins de douze ans quand je me rends compte que la maison est aussi un refuge.
C'est le calme. La paix. La tranquillité, le silence, l'absence de cri, de bruits, d'odeurs. Le rien doux face à la cacophonie de tout le reste. L'odeur étouffante mais familière du vieux bois et des fleurs de maman. J'ai passé des années à espérer quitter un foyer pour découvrir l'extérieur et je me rendais compte, comme le dindon de la farce que j'étais, que je ne pouvais pas le supporter. Que tout m'agressait. Qu'en fin de compte, ils avaient tous raison : je n'étais pas fait pour le quitter. D'ailleurs, je n'étais fait pour nulle part.
La porte se ferme. J'entends les bruits de pas de ma mère, signe qu'elle a entendu mon arrivée et voudrait me saluer, mais pour la devancer, je vais volontairement plus vite. Je me réfugie dans la chambre et ferme derrière moi comme un voleur qui se serait introduit par effraction. Ma mère ne me voit pas beaucoup, pendant cette période. Si j'avais su, d'ailleurs, je ne me serais jamais montré aussi ingrat. Mais j'imaginais, somme toute assez sottement et comme n'importe quelle jeune personne, qu'elle serait toujours là. Qu'elle serait toujours capable de me parler ou de m'entendre. Mais à ce moment-là, toutefois, je ne voulais rien d'autre qu'être seul, à nouveau. Me débarrasser de cette douleur sourde dans le coin de ma tête, de ce brouhaha vampirisant, de cette nuée qui m'écrase la tête et la poitrine.
Seul, il n'y a rien. Rien du tout. C'est le silence, l'attente. C'est un tombeau paisible, mais c'est toujours mieux que le reste. Il y a mes livres, ceux que j'ai déjà lu des dizaines de fois et que je pourrais citer sans faire d'erreurs, les quelques plantes dont je peux m'occuper dans le jardin. Maman est de moins en moins présente, de toute façon. J'ignore depuis quand son travail est si prenant, mais j'évite de m'interroger plus que ça. Je n'ai pas vraiment envie de creuser. Nagisa ne revient quasiment plus qu'une fois la vie tombée.
Mais je me demande, même à cet âge, si c'est normal, d'avoir cette impression de vide froid dans la poitrine en permanence.
La maison est tout ce qu'il reste, pourtant.
--
Je ferme la porte en douceur. Derrière la bicoque qui sert à abriter ma mère, derrière mon bureau au sanctuaire. A chaque fois, sans qu'on ne me suive, le regard fatigué et les yeux baissés, les épaules lourdes d'un poids qui est le mien à porter. Le parfum des médicaments me pique le nez.
Le logement dans lequel ma mère, ma sœur et moi avions été parqués n'est pas une maison ; tout au plus, c'est une pièce de soins. Une pièce de soins où je suis le seul médecin, puisque Nagisa ne me fait plus grâce de sa présence depuis des mois au moins. Tant mieux. La culpabilité remonte toujours dans ma gorge quand j'y pense, mais elle s'amenuise à chaque fois que je pense à ce que je dois faire pendant qu'elle perd son temps à s'apitoyer sur son propre sort.
Le sanctuaire est morne. Depuis la mort d'Erys, j'ai l'impression que son âme est partie avec lui. Est-ce vraiment ça, ou est-ce moi, qui suis désabusé ? Est-ce moi, qui ai perdu ce qui me rendait plein d'espoir ? Ou, alors, est-ce que les images que je me faisais se sont effacées en même temps ? Sans doute est-ce de ma faute. J'ignore quand cette lassitude m'a rendue si aigri et éreinté. J'accomplis mon devoir car on me fait confiance, car on a consenti à me faire confiance, à moi qui n'était rien qu'une déception et une perte de temps. A moi qui n'avait jamais vraiment fait quoi que ce soit d'utile. Je le fais car j'ai demandé et quémandé, même, qu'on me laisse une chance pour ce qui était ma vocation. On m'a laissé cette opportunité. On a même fait de moi un moine supérieur en dépit de tout.
Pourtant...
Pourtant, alors que j'entends la voix d'un novice m'appeler à nouveau pour je ne sais quelle urgence urgente, quelque chose se noue dans ma gorge. Le poids sur mes épaules s'étend à mon ventre. La pensée qui me traverse est amère,
La maison c'est un fardeau.
–
Une porte qui claque, à nouveau. L'odeur fraîche et humide de cette nuit d'été orageuse m'avait semblé presque une agression de plus, lorsque je m'étais retrouvé dehors. Par mes mains, à nouveau. Je ne pourrai jamais dire qu'on ne m'en a pas tendu, mais je les ai toutes renvoyé à chaque fois, sans forcément que je n'arrive à l'expliquer. Il fallait que je les éloigne.
Ce soir-là, ce n'était pas Daichi, qui m'avait chassé. Il ne l'aurait jamais fait. Malgré toute l'inquiétude que je lui avais fait supporter, malgré les tracas que je lui avais causé, il m'aurait toujours accueilli. Il aurait soupiré, grommelé, même, ou m'aurait fixé de ce regard muet mais orageux qu'il avait lorsqu'il était trop dépité pour parler. Jamais, pourtant, il ne m'aurait dit de partir. Il avait toujours souhaité que sa maison soit un refuge pour moi. Même alors que...
Libre à toi de vouloir rejoindre les éclaireurs, mais comprends bien que tu nous mets tous en danger.
Ce n'était même pas un reproche. Même alors qu'il aurait toutes les raisons du monde d'être en colère contre moi, même alors qu'il aurait pu s'inquiéter et, légitimement, privilégier la sécurité de ses enfants qui avaient déjà bien assez souffert de la disparation de leur mère et de leur sœur... Même là, il ne faisait qu'une constatation. Il ne m'obligeait à rien. Il ne me demandait pas de choisir entre ce toit qui avait brièvement été le mien et le reste. Il me demandait de faire attention.
Sur le moment, je ne l'avais pas saisi. Il y avait plutôt dans mon esprit une pensée amère et acide qui rongeait tout le reste, comme si j'étais déjà persuadé de quelque chose et que tout cela ne faisait que confirmer ce que je savais déjà.
La maison, c'est nulle part.
–
J'ouvre la porte. Sans lenteur et sans vigueur, l'expression tranquille, mes traits s'adoucissant lorsqu'une odeur devenue familière de sucre chaud et de cacao remonte à mes narines. Elle s'entremêle à celle des violettes et des bleuets que j'ai accroché dans un coin du foyer. Elles ont bien poussé ; plus que je ne l'aurais cru, à vrai dire. Je ne pouvais pas me résoudre à les laisser mourir dehors, néanmoins.
Je n'ai pas le temps de faire plus de trois pas qu'un brouhaha de pattes glissantes me parvient aux oreilles. Les chiens me sautent sur les genoux et me font grimacer de par leur enthousiasme, à peine atténué par les caresses que je leur offre puisqu'il les quémande en pleurnichant comme si j'étais parti des années.
« Doucement, Smaug. Yggdrasil, tes griffes... »
Je rouspète sans virulence, jetant des coups d'oeil aux ongles de nos – des chiens qu'il faudra penser à couper, à l'occasion. Il est tard, alors ça sera pour un autre jour. J’espérais juste que le vacarme causé par les chiens n'alertait pas l'occupant principal de la maisonnée, dont j'ignore encore la présence ce soir. Il arrive parfois qu'il soit dehors, même si cela me semble être devenu de plus en plus rare depuis peu. Il faudra que je lui demande pourquoi, à l'occasion.
J'entends des sons de ronflement, un peu plus loin. Instinctivement et sans même que je m'en rende compte, un sourire tranquille se dessina naturellement sur mes traits.
J'avance en douceur, mesurant le poids que je pose sur mes pieds pour ne pas provoquer trop de bruit. Sur le canapé, une silhouette est endormie dans une position que je trouverais franchement inconfortable si j'étais à sa place. Il est tard, alors je ne suis pas surpris qu'Enodril ait fermé l'oeil, mais c'est davantage le fait qu'il ne soit pas dans son lit, qui m'étonne quelque peu. M'étonne et ne m'étonne pas, en même temps. Car en jetant un coup d’œil à la scène, je comprends ce qui s'est passé.
Un chocolat chaud traîne sur la table du foyer. Le fumet est encore frais, visiblement. Il a été fait il y a peu de temps, mais son cuisinier ne se l'était pas destiné ; il aurait disparu, sinon.
Il l'a fait... Pour moi.
Mes joues prennent des couleurs. Ma gorge se noue quelque peu. Le geste n'est pas si surprenant, en soi. Il est arrivé, de temps à autre, que je prépare le repas lorsque je savais qu'il rentrerait tard, afin de lui laisser une assiette. Que je lui garde des restes pour qu'il mange autre chose durant sa journée, parfois. Et de la même façon, petit à petit, il s'est mis à faire la même chose. C'est devenu comme un réflexe. Il était devenu impensable de ne pas penser au confort de l'autre, ou de ne pas se demander comment se terminerait sa journée. De ne pas attendre, même, pour prendre un repas. Et c'est ce qui est arrivé ce soir. Il m'a attendu. S'est assis sur le canapé, sûrement en se disant que je ne rentrerais pas tard. Jusqu'à l'épuisement.
En silence, je m'accroupis, pliant mon genou pour observer son visage. Cela fait quelques semaines, maintenant, que j'occupe une part de son domicile. Le temps commence à devenir long. Je sais que j'aurais peut-être dû partir il y a un moment maintenant, et que j'éternise sûrement mon passage. Mon but n'est pas de m'imposer ni de le déranger. Pourtant, j'ai du mal à me faire à l'idée. L'égoïsme de cette pensée me gêne quelque peu, mais parfois, comme ce soir, j'ai l'impression que ma présence ne le dérange pas. Qu'elle lui fait du bien, même, bien qu'il soit possible que j'imagine des choses.
Délicatement, mes doigts viennent se poser sur quelques mèches de cheveux que je replace au dessus de son visage. Le geste est inconscient, comme le sourire doux sur mon visage. Pendant une seconde, juste une, une certitude me traverse. Je ne la comprends toutefois pas encore pleinement. C'est un sentiment plus qu'une pensée. Un nuage chaud, un instant d'écart. Je me sens bien. J'aime revenir ici. J'aime prendre soin des fleurs que j'ai commencé à faire pousser, j'aime m'embêter à y cuisiner même si ce n'est pourtant pas le premier de mes talents. J'aime ouvrir la porte en sachant qu'on m'y attendra. Et je suis sûr d'une chose.
Ce n'est pas tant les murs, que j'ai du mal à quitter.
Peut-être que la maison, au fond, c'est...

Natsu grogne et fixe des fleurs en #8A4B08
 Accueil
Accueil